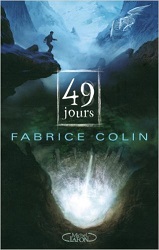Je gardais des écrits de Fabrice Colin un souvenir de tempêtes de sable et de sens, un espace onirique empli de bourrasques aiguisées comme des rasoirs qui débitent l’âme humaine en fines tranches transparentes – puis elles dansent, se froissent et s’émiettent – un exercice de déréalisation digne de Bret Easton Ellis, et Bret Easton Ellis est pour moi le plus grand auteur du Monde de tous les temps, au moins.
C’est pourquoi, quand j’ai ouvert 49 jours, j’ai été étonnée de me retrouver face à un « champ de fleurs ouvert au vent« , un paysage limpide. Je l’ai admiré, plein à craquer de crépuscules opulents, d’aimables dragons volants, d’anges, et de la beauté solaire des corps de vingt ans. J’ai commencé par regretter les ombres de mes souvenirs, puis j’ai dérapé sur le rebord du livre et je suis tombée dedans, plouf !
Ce n’est pas un ouvrage facile à lâcher. J’ai trainé de page en page un sac entier de points d’interrogation (Le héros est-il mort et ressuscité ? Quel est ce gouffre au loin ? A quoi sert cette couronne de fer ? Pourquoi les gens ne font-ils plus caca ?) auxquels l’auteur a la bonté de répondre avant le mot « Fin » et l’habileté de ne le faire qu’au compte-virgules.
L’histoire est simple comme nbvckjhgfuytr. Le héros est celui de Less than zero, un joli jeune homme de la haute qui s’ennuie vertigineusement entre le Champs de Mars et l’avenue de Breteuil. Et puis blam ! Il meurt.
Il meurt et il se réveille au Paradis. Louche, me direz-vous. Certes. Plans dans les plans, amitiés lumineuses fourrées de lames de rasoirs, cascades de sang sur l’herbe verte, le Paradis grimace vite. Pas un seul sourire n’est franc, pas une seule vérité ne tient. Mais le héros s’en fout. Ce qui l’intéresse lui, c’est l’étrange machine à visiter le temps qui turbine au milieu de ce décor de rêve. Une machine à visiter le temps, oui. Une virée chez les dinosaures, une place dans la tribune VIP pour assister à l’assassinat de Kennedy, choisissez votre programme. De jalousie, j’ai commencé à brouter la couverture du livre.
Le héros plonge dans le temps et fait ce qu’il ne faut pas faire : au lieu d’aller vérifier sur place si Henri IV puait autant qu’on le dit ou si Louis XIV recrachait vraiment ses petits pois par le nez, et de compléter sagement ses connaissances historiques, il part sur ses propres traces, à la recherche de lui même. Sa mère en larmes à son propre enterrement. L’errance solitaire de son père. D’année en année, cette catastrophe qui frappe l’humanité. Et enfin, ce qui lui fera préférer le béton glacé de la fin du monde aux plaines du Paradis, un visage de femme. Tout est dit de la nécessité de vouloir pour être.
J’ai épargné les restes de la couverture pour pouvoir baver à loisir de jalousie. Car Fabrice Colin a superlativement cette qualité : il sait donner chair et souffle à ses personnages. Et une grâce parfaite. Le seul problème, au fond, dans 49 jours, c’est qu’il faut maintenant que j’attende le tome suivant…
49 jours, Fabrice Colin, Ed. Michel Lafon, 2012